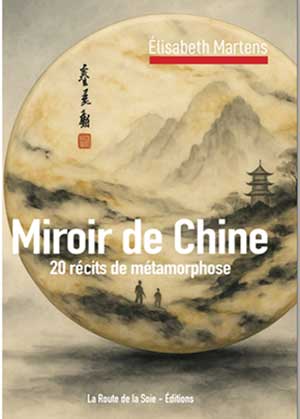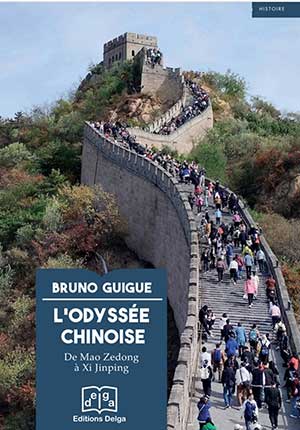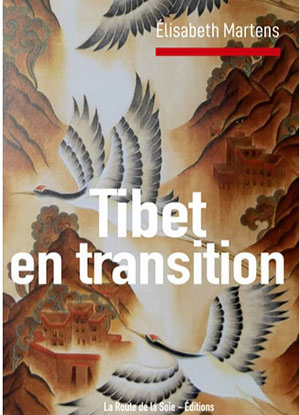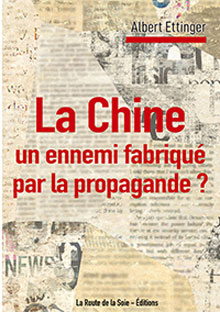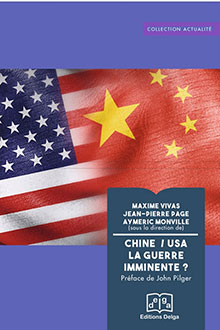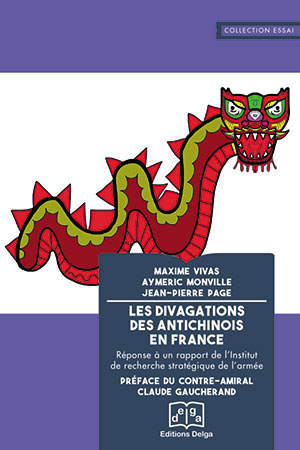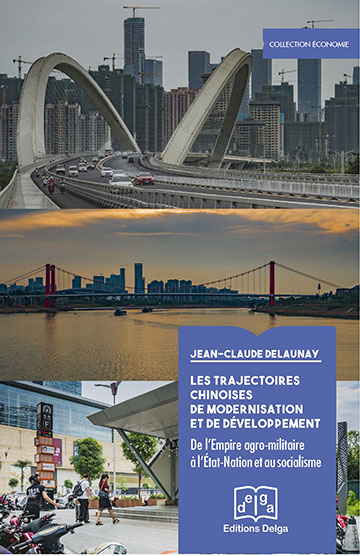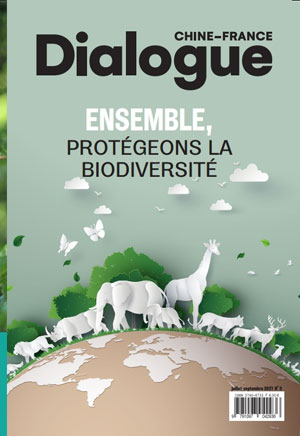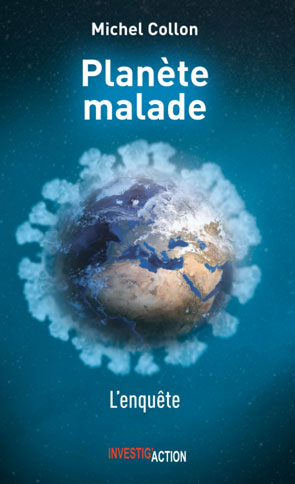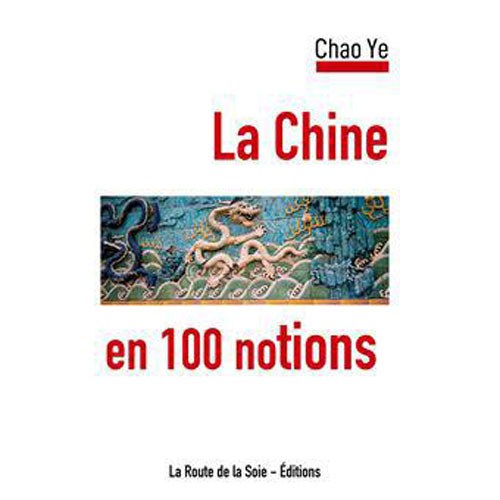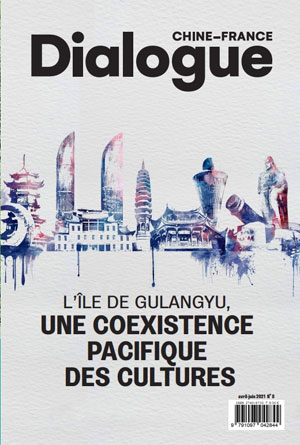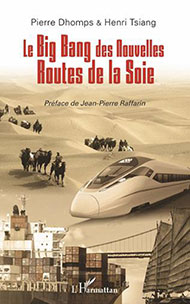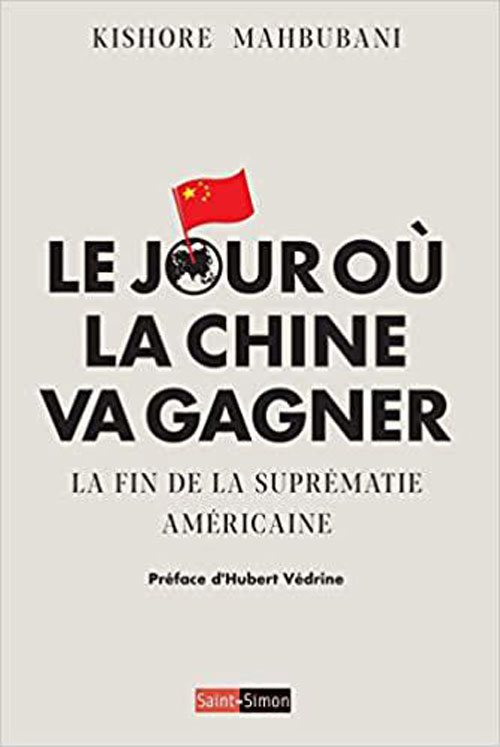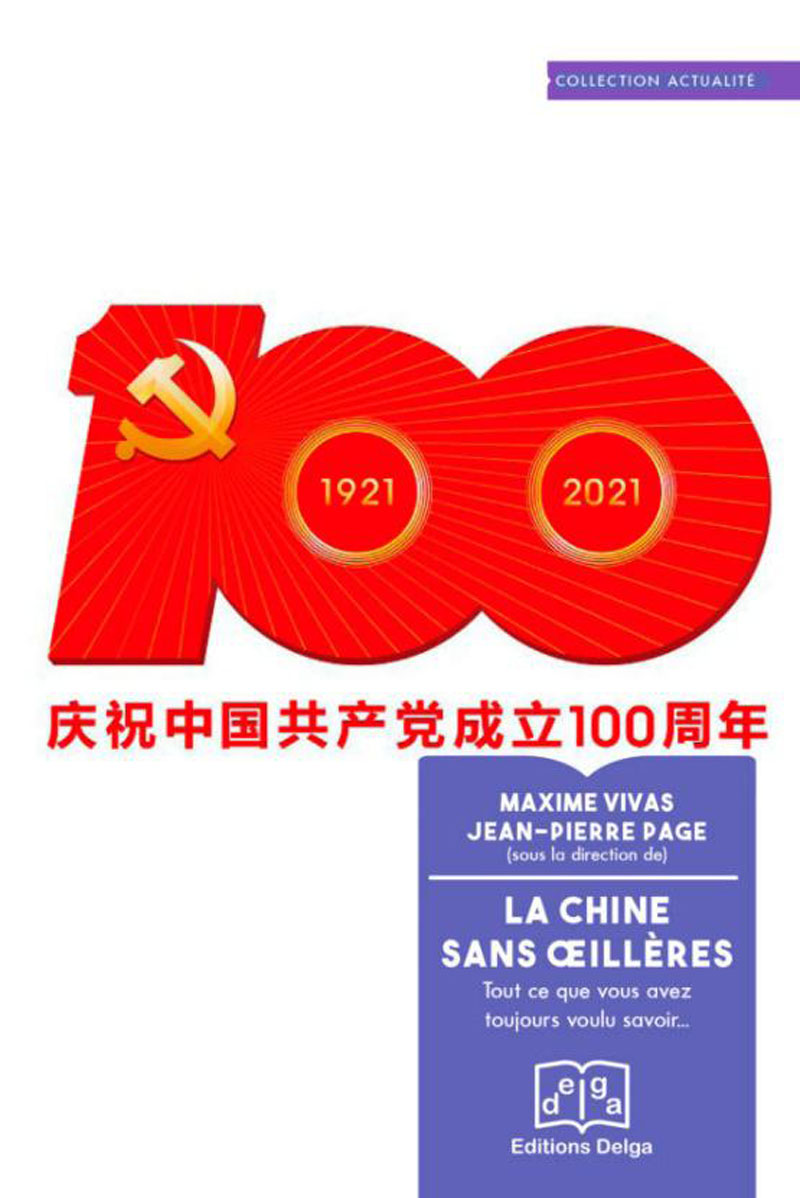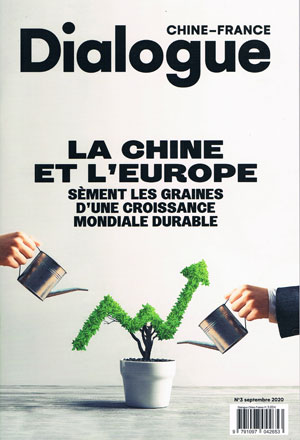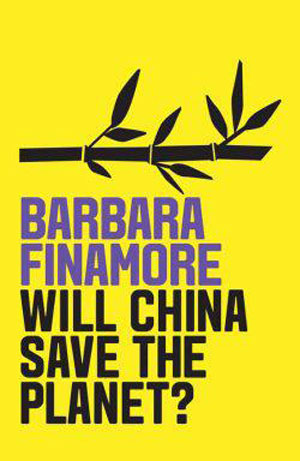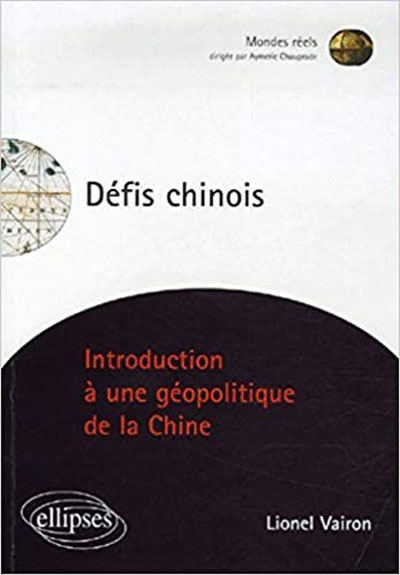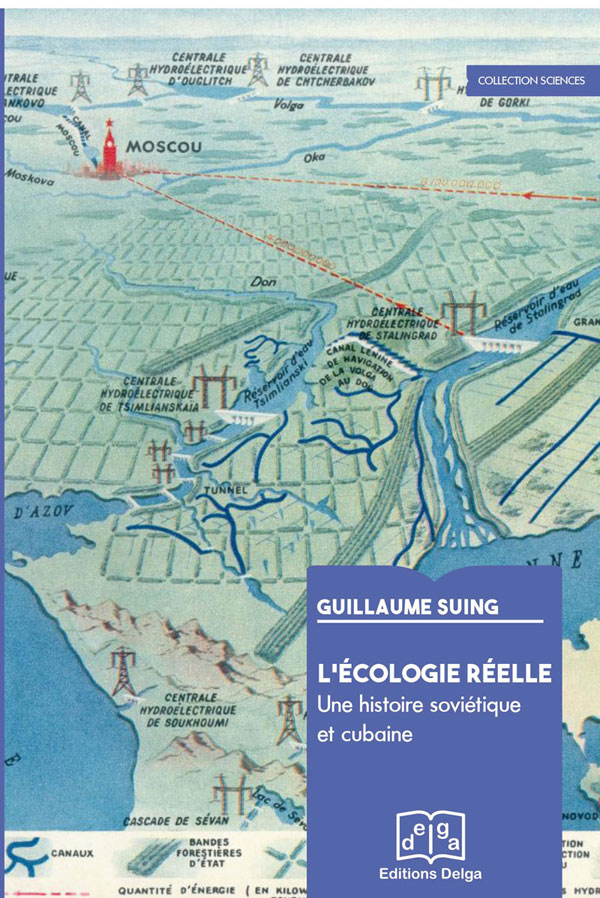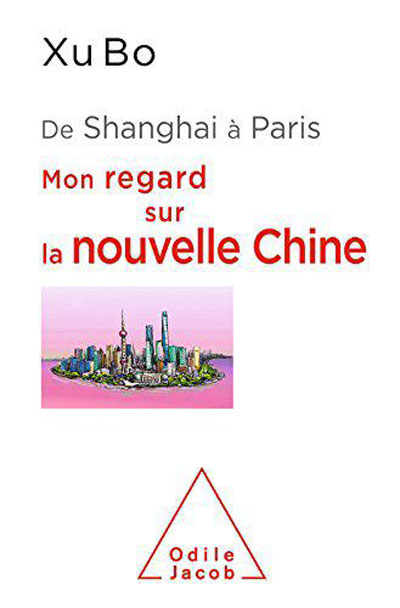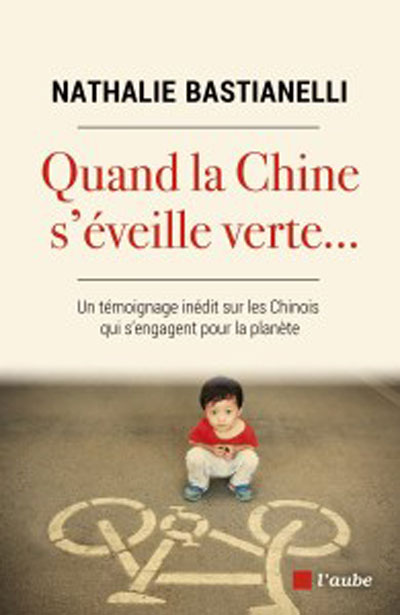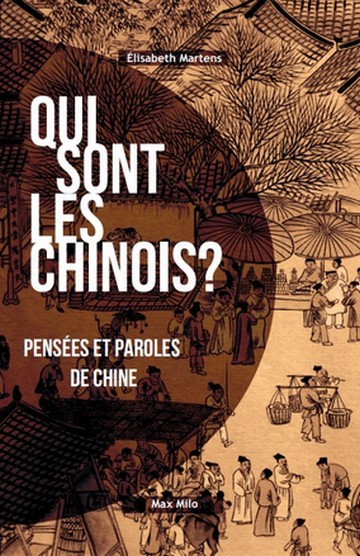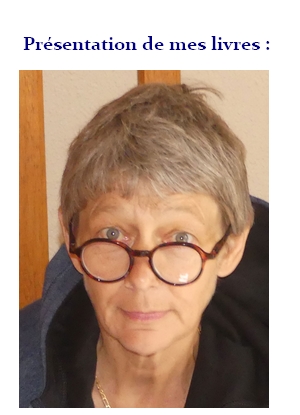Plus les records de chaleur se multiplient, moins on s'en préoccupe
par Marc Vandepitte pour DeWereldMorgen, le 2 juillet 2025
Alors que l'Europe soupire sous des vagues de chaleur record, les responsables politiques semblent faire l'autruche et les plans climatiques concrets ne se concrétisent pas. Comment est-il possible qu'alors que la terre se réchauffe de plus en plus vite, de moins en moins d'actions soient entreprises ?

"La terre se réchauffe
mais le monde se refroidit.
Tout n'a pas encore été tué.
Quoi que vous fassiez,
continuez s'il vous plaît."
Le Sixième Métal[1]
L'été 2025 vient à peine de commencer que les records de température tombent déjà les uns après les autres. En Europe comme aux États-Unis, des millions de personnes sont confrontées à des chaleurs extrêmes dues à ce que l'on appelle les dômes de chaleur, ou heat domes. Il s'agit de systèmes météorologiques dans lesquels une zone de haute pression persistante retient l'air chaud au-dessus d'une région, provoquant une chaleur extrême et prolongée.
En Belgique et aux Pays-Bas, le mois de juin a connu des journées avec des températures de 5 à 10 °C au-dessus des normales saisonnières. L'Angleterre a enregistré le mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés. Dans le nord de la France, le mercure a même dépassé les 40°C, soit 10 à 14°C au-dessus de la température normale pour cette période de l'année.
La tête dans le sable
Pourtant, nos dirigeants politiques restent ostensiblement silencieux. Alors que les gens suffoquent dans des maisons étouffantes, que les agriculteurs luttent contre la sécheresse et que les établissements de santé mettent en garde contre le stress thermique, on n'entend guère de responsables politiques faire le lien avec le changement climatique.Malgré les températures extrêmement élevées, le sommet de Belém sur le climat, qui se tiendra en novembre 2025, risque d'être un échec.
La volonté politique fait défaut, les intérêts fossiles gagnent du terrain et les grands pollueurs restent vagues quant à leurs projets.
Il y a une déconnexion totale entre la réalité et l'agenda politique
Il y a une déconnexion totale entre la réalité et l'agenda politique. On a l'impression que les gens ignorent collectivement la gravité de la situation - ou qu'ils n'osent plus la nommer.
Le paradoxe est flagrant. Jamais auparavant les preuves scientifiques de la crise climatique n'ont été aussi claires. Les océans se réchauffent plus vite que jamais, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses et les phénomènes météorologiques extrêmes se succèdent à des intervalles de plus en plus courts.
Dans le même temps, nous assistons à un retour de bâton politique et sociétal. Les mesures en faveur du climat sont ralenties, reportées, voire supprimées.
Avec des conséquences désastreuses.Même si tous les pays respectent les engagements pris, cela ne représentera qu'environ 30 % des réductions d'émissions nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, comme convenu dans l'Accord de Paris. Il n'est donc pas étonnant que le monde se dirige vers un réchauffement de 2,1°C à 2,8°C, même dans le meilleur des scénarios.
Le « nouveau » déni
Les partis de droite et d'extrême droite gagnent des voix en présentant les politiques climatiques comme élitistes et condescendantes. Les grandes entreprises reviennent également aux combustibles fossiles, sous la pression des actionnaires et des profits à court terme.
L'ancienne forme de déni du climat, qui consistait simplement à nier le réchauffement, a été largement remplacée par quelque chose de plus insidieux : semer le doute sur les solutions.Selon une étude récente, 70 % de la désinformation climatique en ligne passe par ce type de « nouveau déni » : des vidéos et des messages affirmant que les voitures électriques sont plus polluantes que les voitures diesel, que les éoliennes détruisent la nature ou que les énergies renouvelables sont « inabordables ».
Ce discours est moins brutal que le déni d'antan, mais il est au moins aussi préjudiciable. Il ne remet pas en cause les faits, mais sape la confiance dans les solutions, et donc la volonté d'agir.
Un champ de bataille idéologique
Dans tout l'Occident, nous voyons comment les dirigeants (d'extrême droite) transforment la politique climatique en un champ de bataille idéologique. Aux États-Unis, Donald Trump a qualifié les défenseurs du climat de « fous environnementaux qui veulent détruire l'industrie automobile et notre pays ».
Au Royaume-Uni, le premier ministre de droite Rishi Sunak a mis en garde contre la « nounou verte » et a présenté des projets inexistants tels que la « taxe sur la viande », le « covoiturage obligatoire » ou les « sept poubelles différentes » comme des tactiques d'épouvante.L'extrême droite a également réussi à gagner du terrain en Allemagne en attisant la colère contre les pompes à chaleur obligatoires.
Aux Pays-Bas, le mouvement BoerBurger s'est rapidement développé en s'opposant à la politique de l'azote qui, bien qu'elle ne concerne pas directement le CO₂, touche à la politique écologique.
Jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses mesures climatiques n'étaient pas suffisamment justes d'un point de vue social
Le succès de cette nouvelle rhétorique climatique est de traduire les préoccupations réelles des gens - pouvoir d'achat, sécurité des moyens de subsistance et autonomie - en une opposition aux mesures climatiques. Et c'est là que se trouve une vérité douloureuse pour la politique climatique et le mouvement vert : jusqu'à présent, de nombreuses mesures n'ont pas été suffisamment justes d'un point de vue social.On dit sarcastiquement : « Si vous avez du fric, votez vert ».
Des rénovations coûteuses, des factures d'énergie plus élevées, des voitures électriques qui restent inabordables. Pour ceux qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, l'écologie apparaît comme un fardeau supplémentaire.Sans redistribution des coûts et sans investissement dans les infrastructures publiques, la justice climatique devient un concept creux.
Les populistes et l'extrême droite en profitent volontiers. Ils se présentent comme les défenseurs de « l'homme de la rue » face à une élite verte. Et en l'absence de politiques climatiques fortes et soutenues par la société, ce message fait mouche.
Les géants de l'énergie fossile contre les scientifiques
Alors que l'opinion publique se divise et que les hommes politiques hésitent, les compagnies pétrolières et gazières continuent allègrement d'étendre leurs activités. Même les entreprises qui avaient opté pour l'écologisation, comme l'entreprise énergétique norvégienne Equinor, inversent leur stratégie : investir moins dans les énergies renouvelables et plus dans les énergies fossiles.
Pour chaque dollar que l'industrie fossile investit aujourd'hui dans le forage et l'exploration du pétrole et du gaz, seuls 4 cents sont consacrés aux énergies propres et au piégeage du carbone. Chaque année, les cinq plus grandes compagnies pétrolières réalisent un bénéfice combiné de plus de 100 milliards de dollars. Elles n'ont aucune raison de « freiner » volontairement.
Le ralentissement n'est pas un accident. Il est le résultat d'un contre-pouvoir organisé
Et ils sont de plus en plus nombreux à trouver des partenaires politiques pour protéger leurs intérêts. Les groupes de pression sapent la législation climatique à tous les niveaux : ils financent la désinformation, influencent les élections et achètent la coopération des gouvernements. Aux États-Unis, les scientifiques sont réduits au silence et en Europe, les entreprises fossiles gagnent à nouveau en influence auprès des décideurs politiques.
Entre-temps, de plus en plus de climatologues admettent que la situation est plus grave que ne le laissent entendre les rapports officiels. Les modèles du passé se révèlent trop optimistes. Le réchauffement s'accélère, les systèmes naturels se détraquent et les mesures actuelles sont totalement inadaptées.
La Chine montre qu'il est possible d'inverser la tendance
Il est urgent d'opérer un changement radical pour inverser la tendance. La Chine montre que c'est possible. Ce pays offre un contraste frappant avec l'immobilisme de l'Occident. Grâce à des investissements massifs dans l'énergie solaire, les voitures électriques et la technologie des batteries, le pays mène la transition énergétique à une vitesse fulgurante. Même si le charbon continuera à jouer un rôle pour l'instant, le rythme du changement est beaucoup plus rapide qu'en Europe ou aux États-Unis.
La Chine est en passe de devenir le premier État producteur d'énergie verte au monde. La Chine démontre également que pour contrôler le réchauffement, il ne suffit plus de bricoler des taxes et des technologies vertes. Des investissements à grande échelle sont tout d'abord nécessaires, le gouvernement jouant un rôle central d'orientation.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements dans l'énergie solaire et éolienne devraient quadrupler d'ici à 2030, et 5 000 milliards de dollars devraient être consacrés chaque année à l'action climatique d'ici là.
Les pays en développement ne peuvent pas financer cela eux-mêmes. Ils ont besoin de technologies, d'un allègement de la dette et d'une aide internationale d'au moins 1 000 milliards de dollars par an. Jusqu'à présent, les pays riches n'ont promis que 100 milliards de dollars - et ils ne les atteignent même pas.
Pendant ce temps, les pays de l'OTAN prévoient de porter leurs dépenses militaires à 5 % de leur PIB. Si ces plans sont mis en œuvre, cela représentera une dépense supplémentaire annuelle de plus de 1 200 milliards de dollars[2]
1 200 milliards de dollars pour l'armement... et le climat?
S'ils consacraient ces ressources au climat, le monde pourrait être fondamentalement différent.
Outre les investissements importants, les efforts d'atténuation du changement climatique doivent également être socialement équitables. Sans politiques sociales d'accompagnement, les politiques climatiques paraîtront injustes, ce que l'extrême droite ne manquera pas d'exploiter.
Les politiques d'atténuation du changement climatique ne peuvent être largement soutenues que si elles s'accompagnent d'une redistribution équitable.
Les politiques climatiques ne peuvent être largement soutenues que si elles s'accompagnent d'une redistribution équitable : investissements dans le logement social, transports publics gratuits ou abordables, aide aux personnes ayant des moyens limités pour rénover ou isoler. La justice climatique implique que les épaules les plus solides portent le fardeau le plus lourd. Si ce n'est pas le cas, les mesures climatiques deviendront un terrain propice aux protestations sociales et aux gains électoraux pour le camp d'extrême droite.
Un changement de cap radical est nécessaire et il ne reste plus beaucoup de temps. D'ici trois ans, notre « budget carbone »[3]
Le budget carbone est la quantité maximale de gaz à effet de serre que nous pouvons encore émettre au niveau mondial pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5°C.
URL de l'article: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2025/07/02/hoe-meer-hitterecords-sneuvelen-hoe-minder-ertegen-gedaan-wordt/